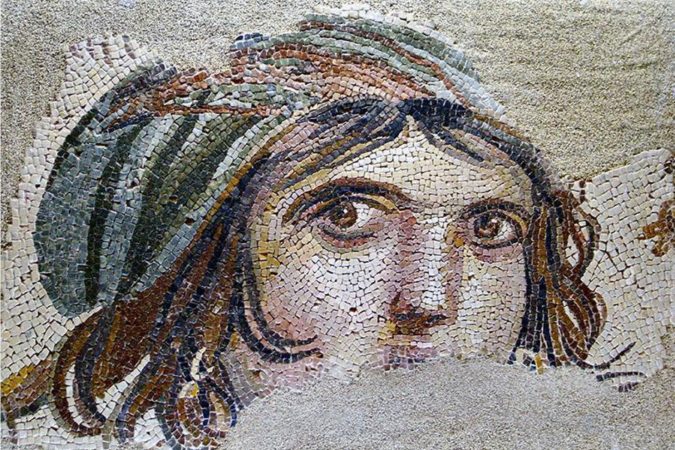Les nouveaux programmes de Langues Vivantes ont paru au BO du 28 mai 2025. Ces nouveaux programmes sont applicables dès cette rentrée en classes de 6ème et de 2nde et leur mise en place sera achevée d’ici la rentrée 2028 avec l’application des programmes en classe de 3ème.
Le préambule annexé à ces programmes précise que lesdits programmes visent à faire acquérir aux élèves « des compétences linguistiques solides, une compréhension culturelle approfondie et un esprit critique affiné. » Les entraînements variés et réguliers y sont présentés « comme essentiels pour développer seul ou collectivement des stratégies » de compréhension et d’expression devant conduire à une indépendance progressive dans les six activités langagières référencées dans le cadre commun à l’apprentissage des langues vivantes. Les contenus culturels sont déclinés en axes et en objet d’étude au collège comme au lycée et des objets d’étude sont proposés pour chaque langue vivante à titre indicatif.
Si le SNALC a pu saluer, de façon générale, certaines dispositions de ces nouveaux programmes dont la hausse des exigences du niveau linguistique, la présence d’un référentiel lexical et grammatical clair et la disparition de la fameuse tâche finale qui orientait jusqu’à présent l’élaboration des séquences pédagogique de tout enseignant de LV soucieux de respecter les attendus, il s’interroge sur les conséquences de quelques nouveautés ou changements pas toujours explicités, en apparence insignifiants.
D’une part, la nomenclature LVA / LVB est désormais utilisée en remplacement de la distinction LV1 / LV2. Ce changement n’est pas anodin, alors que dans l’arrêté définissant l’organisation du collège, qui est un texte au moins aussi officiel que les programmes, il est encore question de LV1 et de LV2. D’autre part, les programmes sont désormais communs pour chaque niveau (6ème, 5ème, … ) et ne tiennent plus compte du nombre d’années d’apprentissage des élèves, seuls les niveaux ciblés diffèrent (A1, A1+, A2…) selon que l’élève est inscrit en LVA ou LVB. Ce changement insidieux est extrêmement problématique en classe de 5ème. Concrètement, un élève de 5ème « subira » le même programme en LVB, qu’il ait démarré l’apprentissage de cette langue en 6ème ou qu’il la démarre en 5ème. Et quelle langue sera la plus impactée, au sens négatif du terme, par cette nouvelle disposition si ce n’est l’allemand qui survit essentiellement grâce au dispositif des classes bilangues ? L’anglais, obligatoire en 6ème, ne sera pas concerné par cette mesure, les autres langues traditionnellement enseignées en tant que LV2 (l’espagnol, l’italien, le chinois, …) ne le seront qu’à la marge.
Le préambule du programme d’allemand relatif à la classe de 5ème qui devra entrer en application à la rentrée 2026 précise bien que la classe de 5ème se caractérise par « une variété de profils d’apprenants » : Certains ont bénéficié d’une initiation en primaire, d’autres ont commencé l’allemand en 6ème LVA avec 4 heures hebdomadaires, d’autres en 6ème LVB avec deux ou trois heures par semaine, d’autres enfin débutent en LVB (appelée anciennement LV2 donc) en 5ème. Il est par ailleurs stipulé que les élèves « poursuivent ou entament leur découverte culturelle et linguistique de l’aire germanophone. »
Le niveau de 5ème est extrêmement problématique en raison de la multiplicité des profils des apprenants. Actant cette hétérogénéité, les nouveaux programmes de LV encourageront objectivement les chefs d’établissements à regrouper les élèves issus des classes bilangues, LVA ou LVB, avec les élèves qui démarrent l’apprentissage de leur seconde langue, alors même que les horaires d’enseignement ne sont pas les mêmes. Les enseignants de LV ainsi que l’ADEAF (Association de Défense de l’Enseignement de l’Allemand en France) ont toujours combattu ces regroupements pour des raisons pédagogiques évidentes. A la clé, des effectifs pléthoriques sur chaque niveau et donc des conditions d’exercice du métier dégradées, des répercussions négatives sur la DHG, en corollaire des postes fragilisés et la multiplication des compléments de service pour les enseignants, notamment en allemand et en italien — d’autant qu’il n’y aura pas lieu de ne pas reconduire ces regroupements en 4ème et en 3ème les années suivantes, puisque le – mauvais – pli aura été pris.
Or, l’année où un élève entame sa découverte culturelle et linguistique d’une langue est fondamentale. Cette année est généralement consacrée aux apprentissages fondamentaux dans la discipline, à l’apprentissage de ce qu’il était convenu d’appeler les bases de la langue et que développaient les manuels consacrés à la première année de l’apprentissage de la langue, que ce soit en 6ème LV1 et 5ème LV2. Notons que ce terme est curieusement absent des 15 pages qui constituent le programme de 6ème.
Le programme de 5ème, qui vise l’obtention du niveau A1+ en LVB et A2 en LVA, précise que « les acquis de chacun contribuent aux apprentissages de tous ». Certains axes culturels et sujets d’étude proposés à titre indicatif se recoupent et pourront effectivement servir de support à une progression commune au groupe (par exemple les axes « Personnes et Personnages » et « Portraits et autoportraits. ») Ces axes, que l’on suggère aux enseignants d’aborder dès le début de l’année, pourront servir à la mise en place d’un lexique de base dans la discipline et amèneront les néo-apprenants à se familiariser avec les réalités sonores de la langue, mais les faux débutants ne risquent-ils pas de s’ennuyer lors de ces séances et perdre leur motivation pour une discipline qu’ils avaient choisi d’étudier dès la 6ème ? Car précisément, les nouveaux programmes aboutiront à transformer tous les élèves en faux débutants avec un niveau de connaissances et des acquis homogènes. Et c’est là que le bât blesse.
Les IPR nous objecteront qu’il appartient aux enseignants de mettre en œuvre des stratégies propres à gérer cette hétérogénéité. A eux reviendra la tâche de diversifier et les approches didactiques et les supports, on encouragera les expérimentations pédagogiques, par exemple le travail en îlots, le recours à l’IA et l’interaction avec un agent conversationnel (tout en engageant une réflexion sur les usages du numérique et de l’IA !). Les germanistes débutants seront systématiquement incités à s’appuyer sur la proximité de l’allemand avec l’anglais (qui semble être devenue la nouvelle langue de scolarisation en lieu et place du français dans les cours de langues vivantes). On limitera également le nombre de séances en plénière dans l’objectif de « répondre à tous les besoins des élèves » et de favoriser l’interaction et la médiation entre les élèves. Les nouveaux programmes obligeront donc les enseignants à se démultiplier, si ce n’est à se contorsionner. Risque d’écartèlement garanti !
Est-il par ailleurs judicieux de faire travailler des élèves en groupes ou en îlots lors des activités de production orale dès lors que les élèves néo-apprenants n’ont pas encore assimilé le schéma prosodique et le fonctionnement phonologique de la langue ? Quel(s) modèle(s) pourront-ils reproduire devant leurs camarades si le professeur n’est plus qu’un simple animateur qui se déplace d’îlot en îlot et veille presque essentiellement à maintenir un bruit raisonnable dans sa salle de classe ? Certes, les acquis de chacun peuvent contribuer aux apprentissages de tous, mais des acquis bancals et fragiles ne sauraient profiter à l’ensemble d’un groupe. Et d’une façon générale, de quelle autonomie peuvent faire preuve des élèves de 5ème, même les plus brillants, dans une discipline dont ils démarrent l’apprentissage et pour laquelle ils n’ont pas acquis les bases linguistiques (lexicales et grammaticales) et phonologiques ?
L’élève est au cœur du système, il lui appartient de construire son savoir, mais on ne peut rien construire sans un minimum de matériaux… Le SNALC maintient que l’enseignant a comme principale tâche la transmission des savoirs et qu’un jeune élève non autonome a nécessairement besoin d’un modèle. Il est légitime de prendre en compte les besoins particuliers de tous les élèves, et donc aussi les besoins particuliers des néo-apprenants, qui ne peuvent être réellement pris en compte que dans un groupe relativement homogène.
L’année de 5ème ne doit pas être une année d’expérimentations hasardeuses, ni pour les élèves qui démarrent l’apprentissage d’une seconde langue, il en va de la réussite future dans la discipline, ni pour les élèves issus des classes bilangues, il en va de leur intérêt et de leur motivation pour la discipline. Mais il en va aussi des conditions de travail des enseignants de langues vivantes, en particulier des enseignants d’allemand, malmenés à chaque réforme. Et d’une façon générale, ces nouveaux programmes ne préfigurent-il pas la disparation des autres langues que l’anglais en tant que LV1/LVA ?
Le SNALC s’interroge et tenait à alerter sur les risques inhérents à une réforme dont le premier objectif – inavoué – semble bien être de réaliser des économies de moyens, une fois de plus, sur le dos de l’enseignement des langues vivantes.
Rédigé par Dominique MANNS, Secrétaire Académique SNALC Lorraine et référente LV